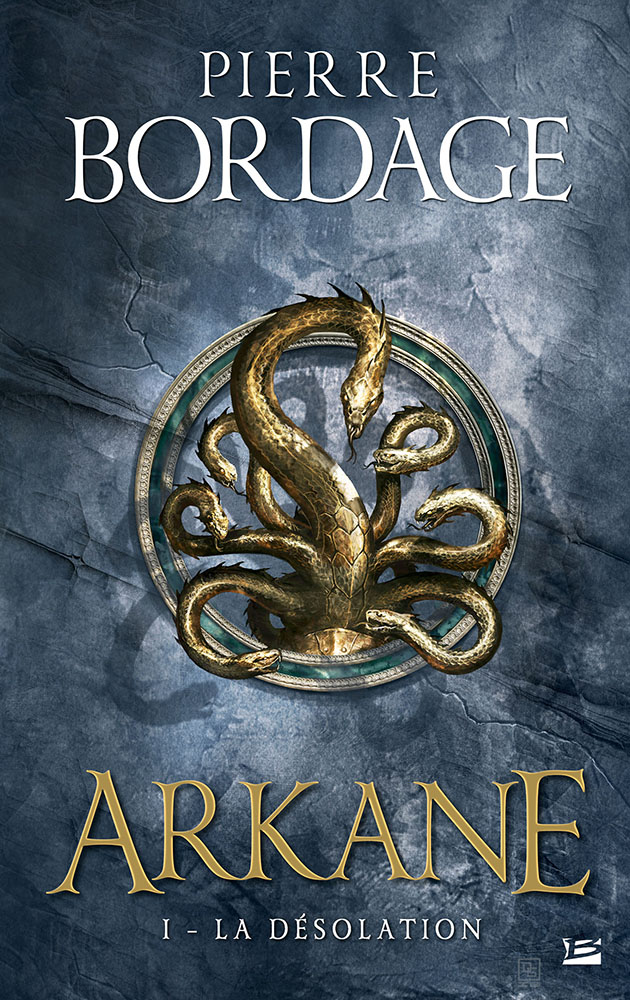Stéphane Marsan est sans doute l’une des personnes qui a marqué le plus l’édition de la fantasy et de la science-fiction depuis une vingtaine d’années, d’abord à la direction de Mnémos où il a accompagné l’émergence d’auteurs francophones comme Mathieu Gaborit, Fabrice Colin ou Pierre Grimbert, puis au sein de Bragelonne qu’il a fondé avec Alain Nevant.
Nous avons eu l’occasion de le rencontrer dans son bureau, où nous avons parlé de sa vision de l’édition à travers son parcours. Une interview sans langue de bois qui s’attarde moins sur le factuel que sur ce qui l’anime dans son rôle de directeur de la publication de l’une des maisons les plus importantes dans le domaine de l’imaginaire.
–Comment est né votre goût pour la fantasy ?
C’est une bonne question. Dans la mesure où je vais la prendre littéralement, c’est à dire comment ce goût est né. Parce qu’en fait mon rapport à la fantasy est plus dans cette espèce de processus génétique que dans la rencontre avec le genre lui-même. J’ai beaucoup lu de mythologies quand j’étais gamin – d’ailleurs, c’est marrant, je lisais des interviews de Pierre Bordage qu’on va publier (chez Bragelonne). Il dit qu’il a été élevé dans une famille très catholique. Il dit que chaque année pour les étrennes, quand il était petit, il avait un livre de mythologie – Je pense qu’il y a là quelque chose de fondamental. Pas seulement pour le décorum de la mythologie, c’est à dire, le héros, les créatures fantastiques, etc. Mais je pense fondamentalement, pour le dire vite, dans sa structure narrative : le voyage du héros, le voyage initiatique, etc.
Moi, ce qui m’a le plus imprégné lorsque j’étais jeune et que je lisais de la mythologie, c’est quand je me suis aperçu petit à petit que je relisais les mêmes histoires. Quand je lisais un livre de mythologie grecque – je parle vraiment de bouquins pour enfants, j’avais neuf, dix ans –, je lisais de la mythologie grecque avec Aphrodite, Zeus et ensuite je lisais de la mythologie romaine avec Venus, Jupiter. En fait, je découvrais de façon empirique, les structures fondamentales des grands mythes de l’humanité. Je pense que d’une façon souterraine et largement inconsciente, cette prise de conscience a été déterminante dans mon travail d’éditeur.
Je parle là de la mythologie, mais je pourrais aussi parler de la poésie qui a été ma plus grande lecture quand j’étais gamin. À dix, onze ans, je lisais essentiellement de la poésie. Ça a commencé évidemment avec les poèmes que je devais apprendre pour l’école et puis j’aimais ça et j’en lisais davantage pour mon propre plaisir.
Je pourrais aussi mentionner les comics de super-héros. Je suis de la génération Strange. Puis la bande dessinée franco-belge. Quand on met tout ça ensemble, sur la table, il n’y a pas de fantasy, mais il y a déjà fondamentalement à peu près toute la fantasy. Il y a de l’imaginaire. Il y a dans le récit graphique une sorte de création fondamentale de l’horizon de l’action. On est déjà dans quelque chose qui est important pour moi dans la fantasy, sa dimension plastique. C’est quand même la seule littérature qui invente totalement son cadre. Elle ne se contente pas de raconter une histoire, mais elle se charge en plus d’inventer : où, quand, comment, pourquoi, depuis quand, etc. L’archétype, dans cette initiative-là, est Tolkien qui met en plus au départ de tout ça, en jeu, le langage qui est vraiment la forge, la matrice de sa démarche. J’ai envie de te répondre que j’ai découvert et aimé la fantasy, bien avant de la découvrir véritablement, bien avant d’avoir en main un bouquin dont je me suis dit c’est de la fantasy.

Je
dirais même que ce point de vue est très présent, peut-être même
de plus en plus important, dans ma pratique d’éditeur au jour le
jour, c’est à dire à la fois en travaillant sur les textes, mais
aussi en les choisissant et en essayant de les partager avec le
public. Je veux dire par là que j’ai sûrement passé l’essentiel
de mes vingt ans de carrière à défendre les genres, en tant que
genre, à essayer de faire en sorte que le plus de gens possible
découvrent la fantasy et se disent : c’est vachement bien,
donc j’aime la fantasy en tant que genre, donc j’ai envie de
découvrir d’autres livres qui appartiennent au genre de la
fantasy.
Je ne suis plus dans cette démarche-là, parce que je crois
aujourd’hui que le plus important, en fait, ce n’est pas que le
public découvre la fantasy, c’est qu’il lise de formidables
romans qui se trouvent appartenir ou pouvant être catégorisés,
selon les points de vue parfois divers des critiques et des
universitaires, comme de la fantasy.
Si le lecteur rencontre le genre
en tant que genre. Formidable ! Mais ce que je veux dire c’est
que ce n’est pas obligatoire. Je ne pense plus que ce soit une
priorité. Et donc le lien avec ce que j’ai dit dans la genèse
préalable, c’est que si j’ai découvert la fantasy, avant de
savoir que ça en était — en fait, j’ai aimé énormément
d’éléments que je retrouverai plus tard globalement regroupés
dans la fantasy. — je pense que le lecteur peut en faire autant.
D’ailleurs, commercialement, médiatiquement, c’est ce qui se
passe. Combien de lecteurs de la saga du Trône de Fer
de George Martin, découvert grâce à la notoriété de la
série télévisée, la désignent comme de la fantasy voire même se
disent lecteurs de fantasy ?
À mon avis, extrêmement peu. Pour
prendre un exemple encore plus spectaculaire qui fait surgir d’une
façon saillante la différence de point de vue que l’on a avec le
milieu anglo-saxon, en France, Harry Potter, personne ne
considère que c’est de la fantasy, à part les universitaires qui
travaillent sur le genre. En France, c’est un roman pour la
jeunesse. C’est à dire quand on arrive dans la jeunesse, dans des
catégories marketing, ou des catégories de segmentations de la
librairie, les genres s’effacent. C’est quelque chose qui m’a
toujours profondément agacé, mais fondamentalement... Je ne suis
pas en train de me demander ce qui est le plus important ou le moins
important. Mais puisque c’est comme ça... Je pense que parce qu’on
est un éditeur de genre, un amateur, un critique, un éditeur, un
organisateur de festival, tout ce qui se passe autour du genre, on
est forcément un militant. On est dans une position de défense.
Parce qu’on se sent opprimé, méprisé, attaqué. C’est normal
et c’est vertueux. Mais, pour moi ce combat aujourd’hui n’est
plus le plus important.
Je ne suis pas révisionniste. Je ne suis pas en train de dire qu’il faut gommer la fantasy, la science-fiction, des ouvrages que nous défendons. Mais fondamentalement, je crois que ce combat, parfois, joue contre nous et que l’on passe plus de temps et que l’on dépense plus d’énergie à défendre, pour le dire vite, la fantasy et la science-fiction qu’à faire partager cette œuvre, ce livre, ce film, cette bande dessinée. Pourquoi ? Parce qu’en fait un public, un lecteur, quelqu’un qui n’est pas familier de ces genres va plus difficilement s’approprier le genre qu’il ne va en fait accepter la simple proposition de dire : j’ai lu ce bouquin formidable ou tu ne connais pas ce livre, franchement tu devrais jeter un œil pour telle et telle raison. Je te donne un exemple très précis. Je pense que j’ai souvent positionné, décrit, défendu des ouvrages auprès de l’équipe commerciale, des représentants, des libraires, des bibliothécaires auprès des journalistes, en disant voilà comment se situe ce bouquin ou cet auteur par rapport à l’histoire du genre. Je l’ai fait sur scène au Salon du livre, etc. Ça n’a rien de honteux. Ce n’est pas inutile de dire que la fantasy, comme la science-fiction, le polar, etc. a une histoire. Qu’entre Lord Dunsany, Conan, Tolkien, Eddings, Gemmel, Martin, il y a de grandes différences et une évolution. Mais en fait, je pense que dans des circonstances où l’on s’adresse à des néophytes, même à des gens qui s’y intéressent un peu, sans être des spécialistes, en fait c’est une connerie.
Ce qu’il faut dire, c’est : voilà de quoi ça parle, voilà pourquoi c’est fort, voilà pourquoi c’est passionnant, voilà ce que vous allez y trouver, voilà ce que vous allez aimer. Et que les gens disent : « Ah ouais, ça me fait envie ! » Si on leur dit, vous voyez Gemmel, vous voyez Robin Hobb, alors c’est quelque chose qui se trouve entre ça et ça. On est dans un discours de spécialistes. On est dans un discours de techniciens.
Ce grand laïus, cette grande boucle, c’est pour dire : on peut se passionner pour la fantasy, comme on peut se passionner pour le jazz ou la psychanalyse ou la mécanique automobile, mais je crois qu’il arrive un moment particulièrement quand on est dans une position que l’on se donne, que l’on s’est vu attribuer par les circonstances, une sorte de mission, de rôle, de partage. Il faut retrouver quelque chose qui est pour moi essentiel à la fantasy, c’est une certaine forme d’innocence et retourner à l’essentiel.
La fantasy stricto sensu, je peux dire très exactement comment je l’ai découverte. Je l’ai découverte avec un petit strip de bande dessinée de Didier Guiserix qui était une publicité pour Casus Belli que j’ai dû voir certainement dans Jeu et Stratégie, qui est un magazine qui n’existe plus. Didier Guiserix était le rédacteur en chef de Casus Belli et aussi dessinateur. Dans ce petit strip, en gros, il y avait des aventuriers qui arrivaient dans une pièce. Ils voyaient un coffre et disaient : « À nous le trésor ! » Ils ouvraient le coffre et il y avait un petit personnage qui dit : « Trop tard coco ! » Il avait un numéro de Casus Belli entre les mains. À ce moment-là, je ne sais toujours pas ce qu’est la fantasy. Je ne connais pas le mot. C’est le moment où il y a une appétence pour une ambiance, pour une esthétique, pour une scène. C’est pour ça que je cite cet exemple très précis où je me dis : ça à l’air trop trop cool ! J’ai la chance à côté de chez moi, sur le chemin du collège, il y a une boutique de jeu de rôle, Jeux Descartes, rue des écoles à Paris. Je passe devant, je rentre, je me prends tout ça dans la gueule. Donc ça commence par des images. Ensuite, je vais me dire, j’ai envie de lire les trucs dont il est question là-dedans. J’ai découvert Lovecraft. Je suis en quatrième. Ensuite j’ai lu Dune. Et ensuite, j’ai découvert l’heroic fantasy. Plus tard, vers dix sept, dix huit ans, j’ai vraiment commencé à lire les classiques, comme tout le monde, Moorcock, Tolkien, Ambre de Zelasny, etc.

– Est-ce que le jeu de rôle a été aussi l’initiateur de votre goût pour la fantasy ?
Oui, le jeu de rôle a infusé la fantasy pour toute une génération et même plusieurs générations. Je citais cette rencontre avec les images, en rentrant dans une boutique de jeux de rôle et avec le petit strip de Casus Belli... Mais, les illustrations des scénarios et des boîtes de jeux de rôle... Je crois que j’avais douze ans quand ma mère m’a offert la boîte rouge de Donjons et Dragons. J’y ai joué des années plus tard. Ça veut dire que pendant des années, j’ai contemplé, j’ai lu et relu et j’ai rêvé à ce qu’on pouvait faire avec ça. Je crois que c’est en effet extrêmement important. (…) Esthétiquement, ce qui s’est implanté en France, par le jeu de rôle notamment, c’est ce qu’on appelait autrefois le médiéval fantastique, c’est à dire une fantasy médiévale et antique qui représente encore largement le genre en France. Au grand dam des gens qui ont envie de choses plus hybrides et qui ont envie de défendre que la fantasy c’est aussi Tanith Lee, Neal Gaiman, etc. Assurément. Je dis souvent, je suis comme un Saint Thomas.
Je ne crois que ce que je vois. En tant qu’éditeur particulièrement je dois faire avec le phénomène, avec ce qui apparaît autour de moi, dans la réalité. Et ce qui apparaît autour de moi, dans la réalité, c’est que quatre-vingt pour cent de la fantasy représentée en librairie, c’est de la fantasy médiévale. Quand on dit aux gens « fantasy », ils voient des épées, des sorciers, des dragons. C’est de ça qu’il s’agit dans ce qui a été approprié par le public et le jeu de rôle se taille la part du lion. Les jeux de rôle qu’on pourrait catégoriser comme fantasy et qui ne sont pas du médiéval fantastique sont quand même extrêmement rares. Ce qui est extrêmement intéressant avec le jeu de rôle, c’est la boucle. C’est cette espèce de cercle vertueux. La fantasy a influencé la création de jeux de rôle. Et en retour le jeu de rôle, sa pratique, son existence, l’appropriation de l’univers par les joueurs ont fait découvrir la fantasy. C’est bien cette fantasy-là, cette fantasy médiévale qui s’est retrouvée sans cesse rétablie, relégitimée, re-imposée comme si la fantasy médiévale était le synonyme de la fantasy tout court.

– Avec Mnémos, toute une génération de jeunes auteurs francophone est apparue. Comment expliquez-vous cette émergence ? On a l’impression que la fantasy française se cristallise à partir de votre travail chez Mnémos.
C’est un très bon terme « cristallise ». Parce que j’ai toujours été mal à l’aise avec des assertions qui évidemment me font très plaisir, mais ne sont pas très justes du genre, « c’est Marsan qui a créé la fantasy française avec Mnémos. » Évidemment, ça me fait plaisir, mais « cristalliser » c’est beaucoup mieux.
Je pense qu’il y a eu un ensemble de procédures dont je n’ai pas été conscient qui ont permis cette cristallisation. Si « cristallisation » me paraît plus juste, c’est qu’il y a eu de la fantasy écrite par des auteurs francophones et en particulier français avant Mnémos et autour de Mnémos. Il y en a à l’Atalante, il y en a au Fleuve Noir, il y en a chez d’autres éditeurs au même moment. Avant, dans la collection Anticipation du Fleuve Noir, — j’ai réédité ses œuvres complètes — Julia Verlanger a écrit de la fantasy. Bernard Simonet écrit de la fantasy. L’histoire de la fantasy française commence avant 1995 et Mnémos. Ce qui se passe à ce moment-là, c’est aussi un résultat de la mise en place du jeu de rôle en France. Concrètement, moi-même, quand je crée Mnémos, je le crée avec l’équipe de la boîte de jeux de rôle dans laquelle je travaille qui est Multisim. Au sein de Mnémos,vont être publiés des gens qui étaient aussi des auteurs de jeux de rôle, comme Fabrice Colin, Mathieu Gaborit. Je veux dire des auteurs professionnels de jeux de rôle qui écrivaient ou publiaient dans Casus Belli comme Fabrice Colin ou des gens qui pratiquant le jeu de rôle en sont venus à avoir envie d’écrire des aventures de fantasy comme les Américains l’avaient fait 20 ou 15 ans avant, comme David Eddings, comme Raymond Feist. De facto, ils sont français, parce qu’on est dans le milieu du jeu de rôle français.
Je pense qu’il y a aussi quelque chose de générationnel. Je pense que c’est aussi le moment où en francophonie, avec d’autres supports, dans d’autres arts que la littérature, le même phénomène se passe. Besson fait du cinéma. La bande dessinée francophone a Thorgal, L’oiseau du temps, Astérix. De la fantasy, il y en a pléthore.
Troisièmement, je pense qu’il y a... très immodestement... c’est globalement moi que ça concerne. C’est tout simplement, si je puis dire, un éditeur qui décide de publier des auteurs français. Là, non plus, je ne suis pas le premier, mais je serai celui d’une façon largement innocente, encore une fois — innocente, parce que spontanée — qui va dire, publions des auteurs français.

– Ça va créer une impulsion.
Exactement, ça crée un appel d’air. Ce qui fait que des gens comme Alexandre Malagoli, Laurent Kloetzer vont venir me voir –Kloetzer, littéralement. Un jour, il rentre dans le bureau. Il passe la porte et dit, bonjour, c’est bien ici les éditionsMnémos. Il dit : et bien voilà, j’aime beaucoup ce que vous faites. J’ai lu vos bouquins. Moi aussi, j’écris de la fantasy. Est-ce que je peux vous proposer un manuscrit ? Ce sont des gens qui vont venir me voir et m’apporter des manuscrits parce qu’ils ont lu les premiers romans de Mnémos et qui se disent et bien globalement si je dois publier mes romans de fantasy, moi qui suis français, il n’y guère que là que je peux le faire. Il y a donc un appel d’air, une rencontre. Il y a une volonté militante. Parce que je me dis pourquoi ne pas le faire. Quelles seraient les raisons de ne pas le faire ? Si elles existent, il faut les désamorcer, les battre en brèche.
C’est un peu plus tard que je commencerai à rencontrer mes homologues dans la profession. Et des grands. Marion Mazauric qui est à l’époque directrice littéraire chez J’ai Lu et qui est très engagé dans la science-fiction, comme elle l’est toujours Au Diable Vauvert, la maison d’édition qu’elle dirige. Jacques Goimard qui est le patron de pocket SF a amené quasiment toute la fantasy dans ce pays en publiant Eddings, Moorcock, etc. Et quand j’aurai la chance de déjeuner avec Jacques Goimard, il va m’expliquer pourquoi il n’a pas publié de fantasy française. Il va d’abord m’expliquer pourquoi il a arrêté la science-fiction française parce que globalement ça ne se vend pas assez. Ensuite, il m’a dit avec beaucoup d’ironie, parce que c’était quelqu’un de très ironique qui m’a beaucoup aidé qui m’a beaucoup encouragé et en même temps a toujours trouvé les occasions en gros de me rabattre un peu mon caquet et me dire : « Petit gars, tu es tombé, de la dernière pluie. On a fait deux, trois trucs avant toi. » Puis, Jacque Sadoul a fait la même chose, Patrice Duvic, aussi.
Enfin bref, tous les grands que j’ai eu la chance de rencontrer, mes prédécesseurs dans l’édition de l’imaginaire. Goimard m’a dit, en gros : « Ce que tu as fait, on avait tous des raisons de ne pas le faire. On ne pouvait pas dire que ça ne marcherait jamais. (Finalement, il commençait à m’apprendre la prudence de l’éditeur qui dit, il ne faut jamais dire, jamais) Toi, tu l’as fait. Ça a marché. Super ! » En même temps, vu que c’est quelqu’un de très pragmatique, il m’a dit, définissons, ça a marché. Évidemment, je m’en rendrais compte bien plus tard avec Bragelonne qui est une maison qui a beaucoup plus d’ampleur, de puissance, mais qui a aussi beaucoup plus de charges que Mnémos, et aussi plus d’exigences. Certes, il s’est passé quelque chose au démarrage de Mnémos, c’est-à-dire que Soufre-Jour de Mathieu Gaborit vend cinq mille exemplaires, quand on est un micro éditeur avec la diffusion que l’on a, c’est absolument inespéré. Là, il y a la rencontre avec un public qui attendait ça sans espérer que quelqu’un le fasse, en gros. Et aussi parce que c’est des super écrivains. D’une part aujourd’hui, je le dis un peu par provocation, mais globalement, je pense que c’est réaliste de le dire. Je pense que je ne publierai pas Souffre-Jour de Mathieu Gaborit. Parce que je dirai, il y a là quelque chose d’extraordinaire, mais j’aurai toutes les raisons que Goimard avait à l’époque de dire, ouais, mais je ne vais pas le faire parce que ce n’est pas très bien foutu. Il y a beaucoup de travail.
C’est un imaginaire très particulier. C’est écrit à la première personne. Bref. Il y a quelque chose d’intimiste, il y a donc quelque chose qui commence à définir ce que pourrait être spécifiquement une fantasy française, dans son propos, dans son style. Bon Dieu ! Qu’est-ce que j’ai bien fait de le faire à l’époque ! Pour le dire aussi d’une façon un peu lapidaire et un peu provocante. Je pense que si j’ai cristallisé la fantasy française chez Mnémos, c’est aussi parce que les autres éditeurs m’ont laissé le faire en décidant ne pas le faire eux-mêmes. L’histoire se répète d’une certaine façon, car aujourd’hui, je vois des éditeurs comme Les Moutons Électriques, par exemple, faire émerger avec goût, avec succès, avec intelligence des romans de fantasy que moi, aujourd’hui, chez Bragelonne, je pense que je n’aurais pas publiés si on me les avait proposés.
Et si ça se trouve, ces gens m’ont envoyé un manuscrit et on l’a refusé. Parce qu’ils font d’autres choix que moi. Ils ont d’autres intuitions que moi. Ils prennent sûrement d’autres risques que moi. Moi, je prends d’autres risques qu’eux. Mais je ne veux pas dire que ma plus grande fierté c’est que ce soit quelqu’un d’autre que moi qui le fasse maintenant, parce que je continue à le faire. Je publie Pevel, Fargetton, Gay. J’en publie des auteurs de fantasy français. Toujours. Mais il est heureux de voir que quelque chose qui ressemble à l’impulsion, à l’appel d’air, à la démarche, au geste qui a eu lieu à partir de 1995 chez Mnémos, sous ma direction, est aujourd’hui accompli par d’autres éditeurs. Je ne sais pas si je les ai inspirés, mais j’ose croire que ça ne se passerait pas si ça ne s’était pas passé au milieu des années 90.
Pour aller plus loin, on vous donne rendez-vous pour la seconde et dernière partie de notre long entretien avec Stéphane Marsan, que l'on remercie pour son temps et sa sagesse !