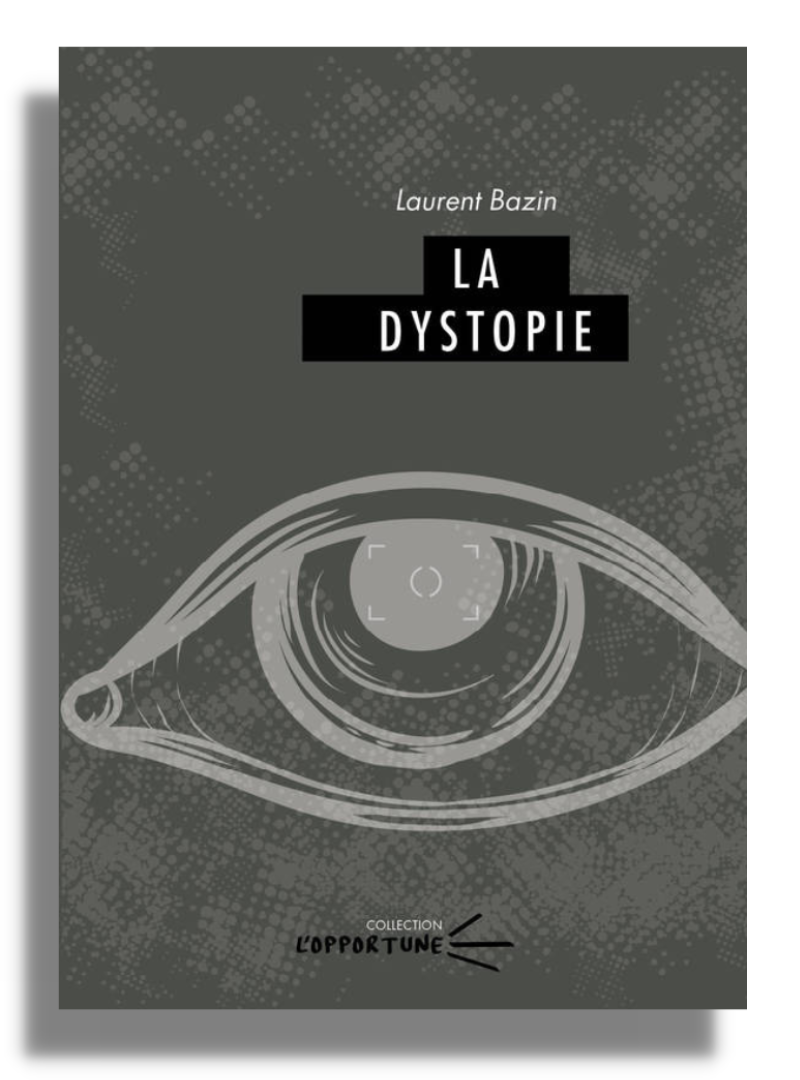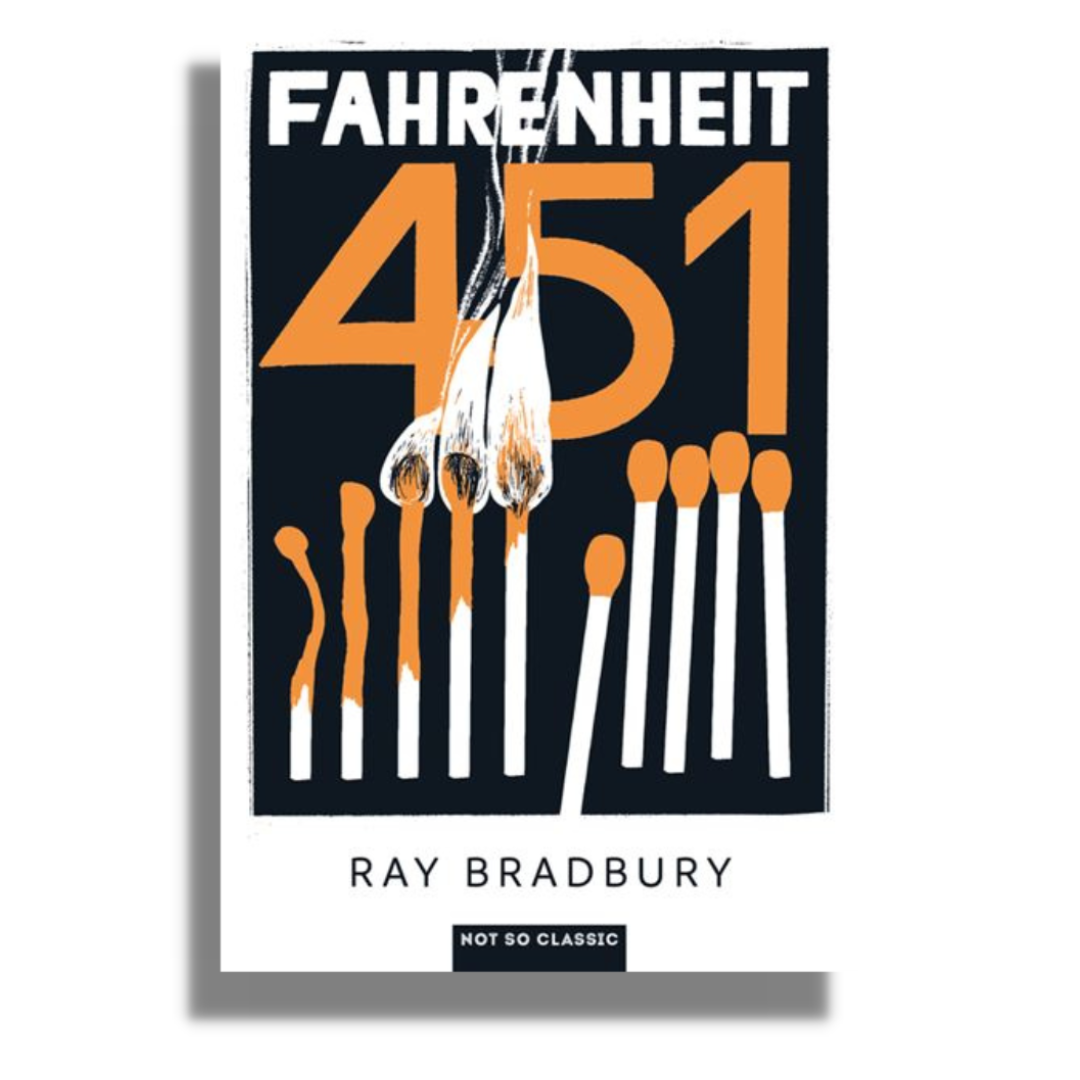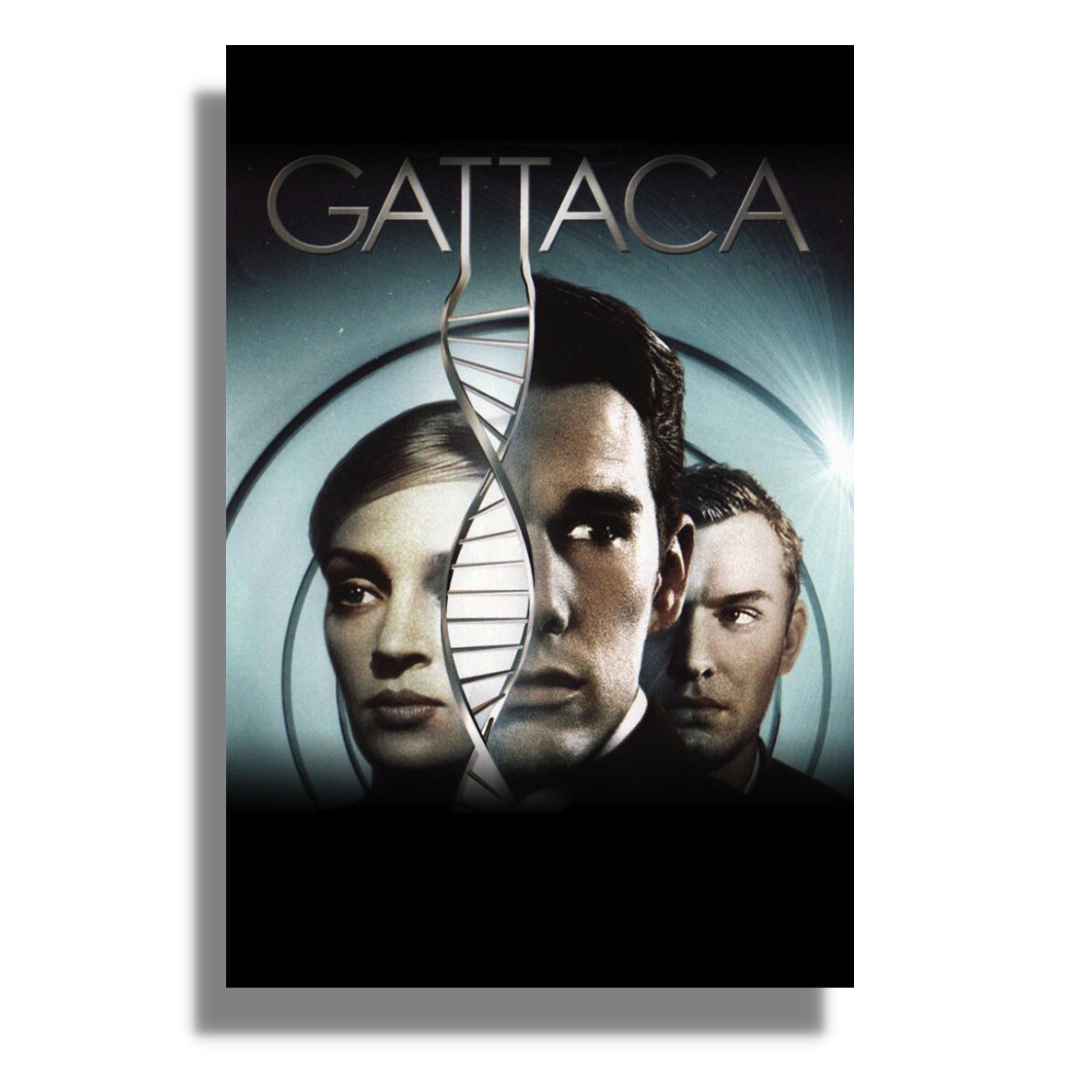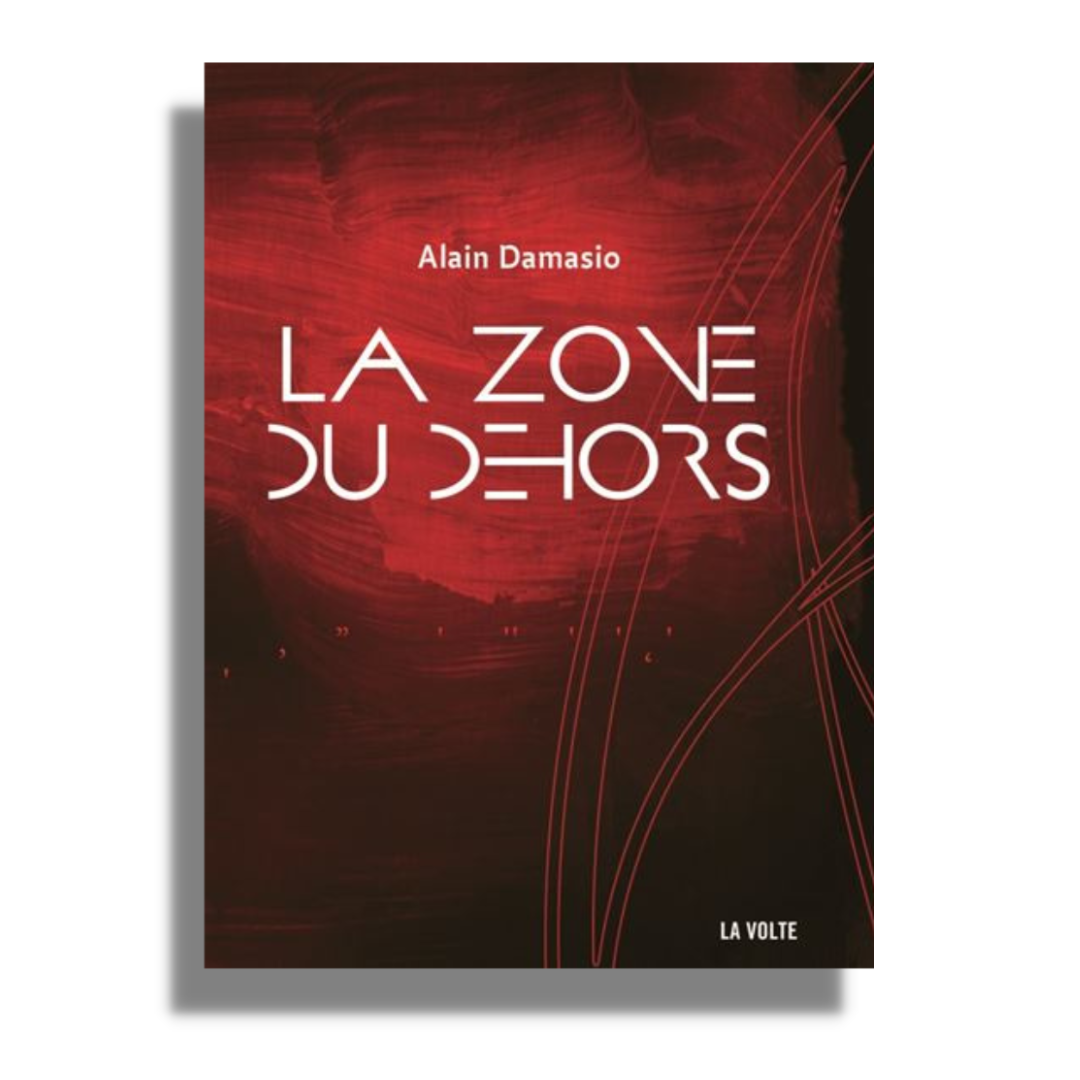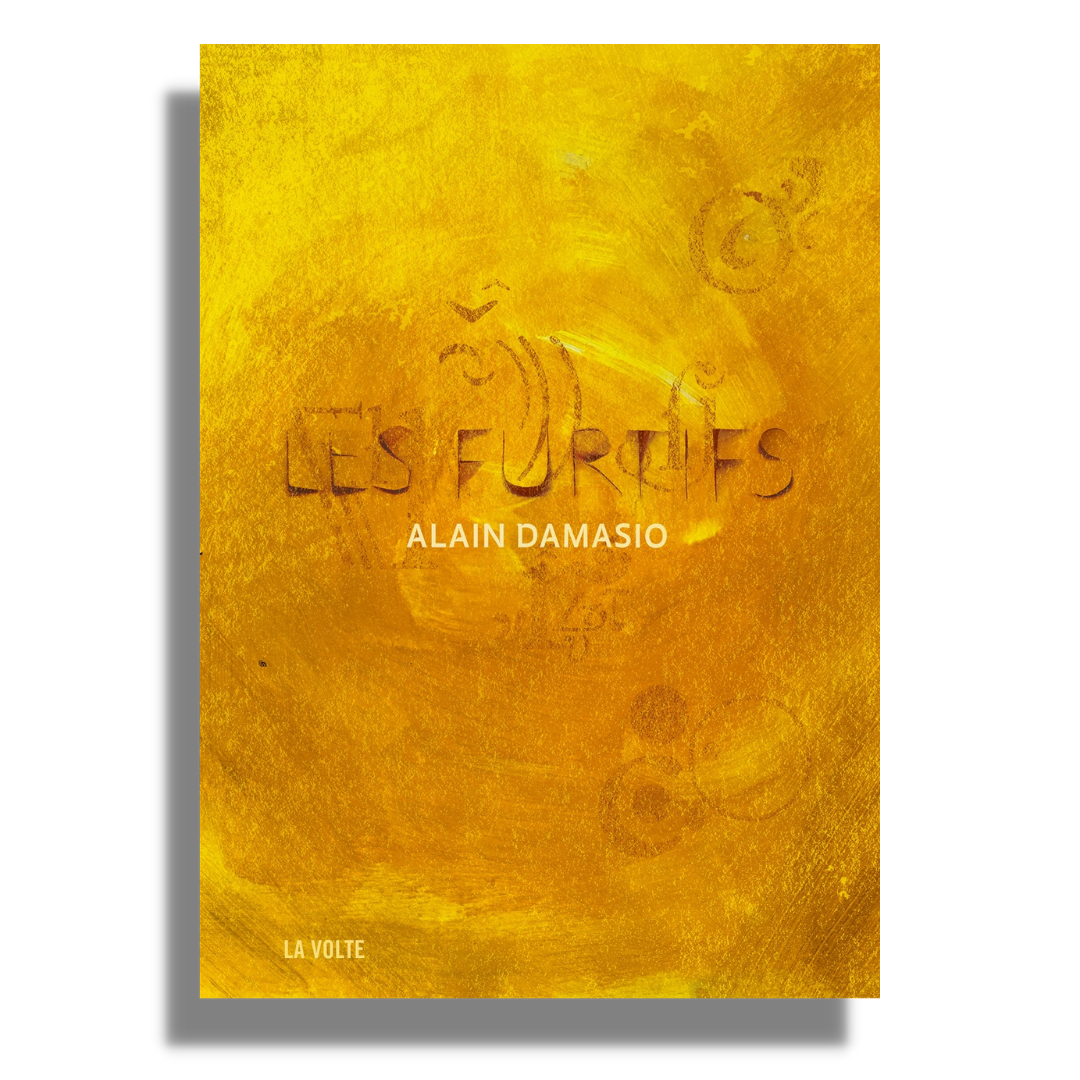1.
| Fins et moyens
C’est bien connu, l’enfer est pavé de bonnes intentions. On peut en dire autant des univers dystopiques : les buts qu'ils se donnent sont souvent louables (égalité, harmonie sociale, écologie dans certains cas), et pourtant nous restons souvent saisis d'horreur en les découvrant. C'est que, si les fins sont louables, les moyens employés pour les réaliser sont toujours discutables, et, de là, pour le moins contestables sont leurs résultats.
C'est sur cette contestation que se concentre la dystopie. Refuser, se révolter, c'est désirer autre chose. C'est réinstaurer le débat, le compromis, la politique, et c'est une émancipation, sensible et intellectuelle. La dystopie, comme prolongement de l’utopie, est un genre littéraire engagé et politique, qui construit ses récits sur le devenir du vivre-ensemble.

Tous les univers dystopiques sont organisés autour de la mise en scène d’un idéal : l’harmonie sociale et le bonheur pour tous dans Le meilleur des mondes d’Huxley, une alliance constructive entre les factions dans Divergente. Et ces univers sont ils un échec des idéaux qu'ils défendent ?
Les "Epsilons" de Huxley sont bêtes et laids, à cause des manipulations subies par leurs foetus, mais ils ne protestent pas. Ils sont heureux pour de vrai, leur être correspond parfaitement à leurs fonctions. Une huître ne souffre pas de n'avoir pas de jambes pour marcher, elle a son rocher ; il en est de même pour les Epsilon, qui n'ont ni intelligence ni désir, mais qui ont cette drogue appelée Soma.
Ce qui fait du Meilleur des mondes un échec, c'est non pas le malheur des personnages, mais ce qui est laissé pour compte, afin d'atteindre à ce bonheur horrible. Ainsi, Huxley fait de son livre un plaidoyer pour la santé, l'intégrité physique et mentale, pour l'éducation, contre l'industrialisation et la reproductibilité, qu'il étend jusqu'à l'être humain.
La dystopie, avec ses traditions et, on peut le dire sans exagérer, ses penseurs-romanciers, a finit par développer ses propres systèmes d'équivalence. Un acquis ne se fait pas sans perdre quelque chose ailleurs - qu'un système politique cherche, vraiment à tout prix, l'adhésion de ses citoyens, ne serait-ce que pour n'exclure personne ?
Que cet État refuse d'employer une autorité violente pour mater les réfractaires, qu'il veuille éviter l'émeute, ou bien le crime, sans se faire l'ennemi de la liberté ? Il agressera l'imagination même des gens, l'étouffera, de peur qu'un jour quelqu'un puise dans son seul désir la force de créer des alternatives au monde qu'on lui impose. Voici Fahrenheit 451.
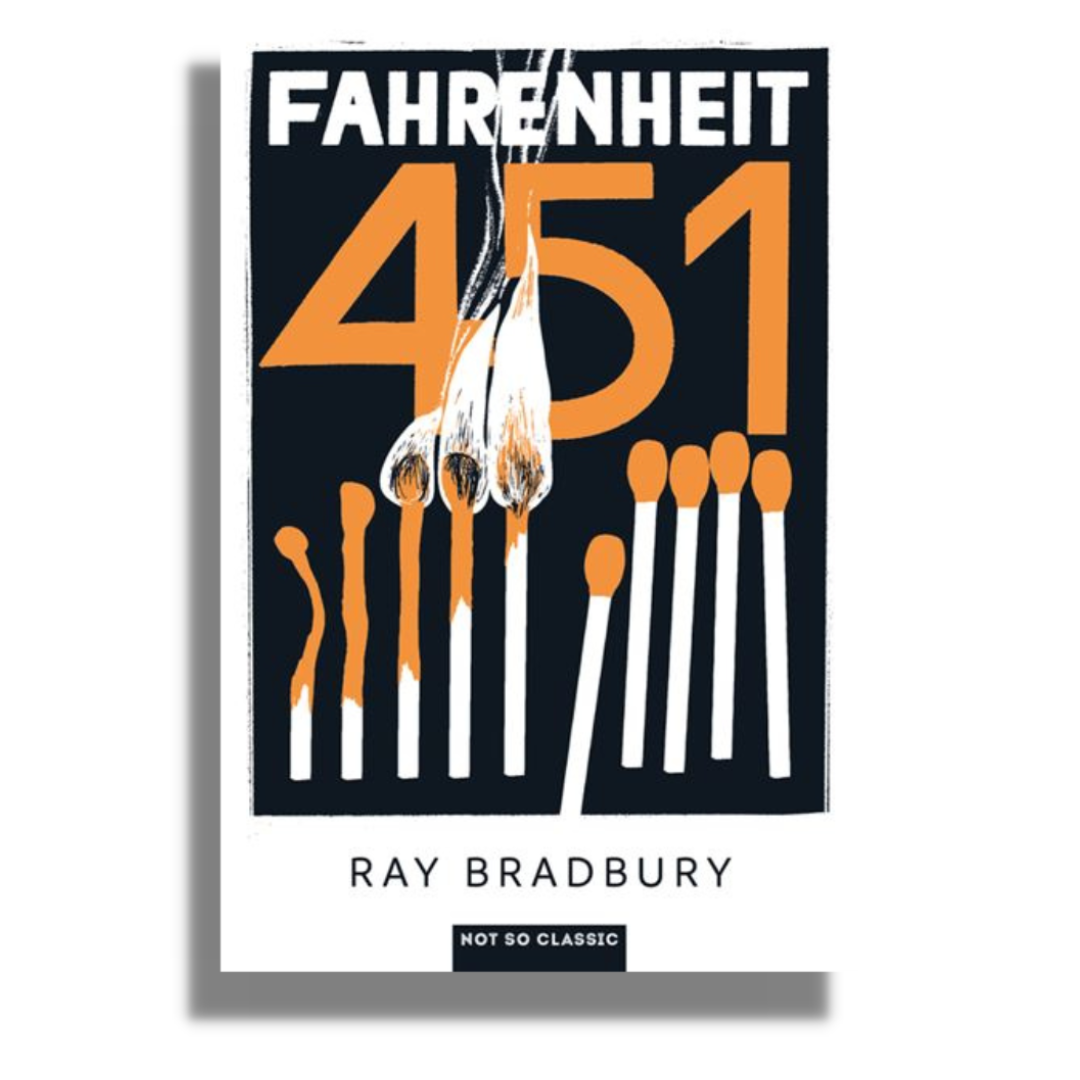
On pourrait croire que la dystopie prône un genre de libéralisme où l'État devient nécessairement l'ennemi de la liberté individuelle. Ce n'est pas du tout ça. L'individu compte, dans le récit dystopie, parce qu'il inaugure la politique, à la fois comme volonté générale et comme définition de la part irréductible de la liberté humaine. Mais dans le cadre dystopique, cette liberté ne s'accomplit que dans l'invention d'un nouveau vivre-ensemble, qui ne la contredit pas. L'avenir y est toujours collectif.
La dystopie ne se contente pas de mettre en scène la lutte entre deux modes de gouvernement, démocratique et tyrannique, l’un bon et l’autre mauvais. Ses fondateurs ont pour beaucoup été témoins des faillites de la démocratie au 20e siècle, et de la manière dont les urnes ont amené au pouvoir des gouvernements autoritaires. L'État peut bien être l'avatar du groupe, et terrible, si par ses méthodes de gouvernement il réussit à faire que ses ses ressortissants se croient... des huîtres, en quelque sorte.
C’est réalisation des idéaux qui est interrogée, et aucun gouvernement n’est à l’abri des erreurs dénoncées par la dystopie. Mais en même temps, la dystopie donne une certaine idée désirable de ce qu'est l'être humain, et qui est désigné à la fois comme un but à atteindre, en dehors duquel la vie est inacceptable.
En fait, la dystopie c'est en bonne partie une perversion des concepts (la sécurité se change en surveillance, l’unité devient uniformisation, etc). Mais, surtout depuis ces dernières années, elles ont à coeur de proposer des remèdes à ces perversions, derrière chacune desquelles se trouve l'aliénation des personnages, le renoncement à soi, l'avilissement.
Qu’il s’agisse d’Hunger Games ou de 1984, l’amour devient le premier acte par lequel les personnages s’emparent de leurs existences. Et, suite à ce recentrement intime de la vie, ces dystopies explorent les différents moyens plus concrets de subversion. L'amour est le début du refus dystopique, parce qu'il est le premier acte par lequel on reconnaît sa propre valeur.
2.
| Le progrès
La pensée occidentale du progrès le définit, du moins en ce qui concerne la technique, comme la capacité à modéliser la réalité - de même qu'on modéliserait un volume en informatique. Le but est de la comprendre en la représentant de manière logique, c'est à dire en termes de causes et d'effets. C'est pour cette raison qu'on a tendance à décrire les choses par leurs fonctions, et la pensée scientifique permet de détourner ces fonctions, de transformer le réel.
Cette façon d'appréhender les choses ne va pas de soi. Pour reprendre la belle expression de Laurent Bazin, « toute construction scientifique encadre le monde, à savoir qu’elle le comprend en même temps qu’elle le contraint » - ce qui veut dire, aussi, que la science définit le réel en fonction des buts qu’elle se donne, et qu’elle en oblitère une partie (par opposition par exemple à la philosophie grecque, dans laquelle la connaissance vise à l'élévation morale du philosophe).
Quand la dystopie parle de la science, c'est la plupart du temps pour en montrer les limites ou l'arbitraire. Ou, pour parler plus précisément (car les scientifiques sont bien sûr tout à fait conscients de ce point) les dystopies montrent l'usage idéologique qui est fait des sciences et de la technique.
La manière la plus éclatante de dévoiler ce détournement du discours scientifique est d'appliquer ces techniques à l'être humain - ce pourquoi sont souvent mêlés, thématiquement, progrès et domestication de l'être humain. Alors, on comprend mieux ce qu'implique la technique : à la connaissance de soi est substituée la maîtrise des émotions, des sentiments, des pensées ; elles servent un usage qui n'est pas défini par soi-même ; la liberté s'efface en faveur du contrôle.
De genre de situation naissent des conflits intérieurs riches d’un point de vue scénaristique. Le personnage doit choisir entre suivre ses désirs que nie la société, et son intégration à une société qui l’empêche d’être heureux. La libération du personnage concernera, quant à elle, sa situation réelle, matérielle et sociale. Ce type de système narratif permet d'associer parfaitement profondeur des caractères mis en scène et la création d'un univers complexe, où peut se déployer largement la critique dystopique.
Il est un exemple fameux d'un film de ce genre : Bienvenue à Gattaca, sorti en 1998.
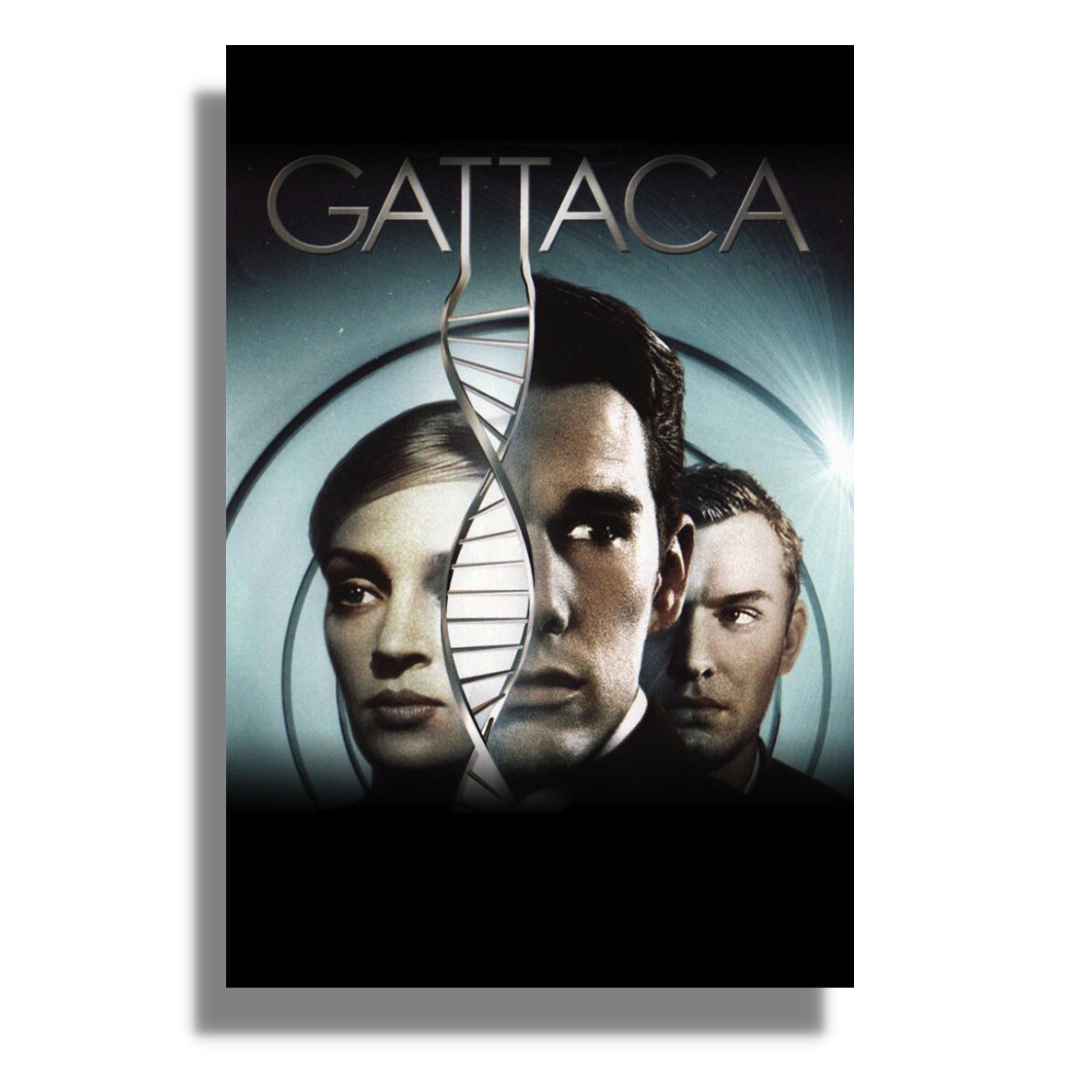
Don't look up (qui, comme satyre glaçante, emploie à foison des procédés dystopiques) illustrait un autre problème de la technique, plus contemporain. Par sa capacité à transformer le réel, et parfois, il est vrai, de manière imprévisible - on serait tenté de dire, magique, la technique prend le devant sur le réel, le rend caduc. Dans Don't look up, c'est illustré par le fait qu'aucun scientifique n'est consulté pour le valider le projet des drones de BASH. Or, ces drones échouent, ces drones et la richesse à laquelle ils devaient donner accès s'avèrent n'avoir été qu'un rêve.
La technique, c'est justement le rêve d'un pouvoir infini sur la réalité ; c'est un rêve, ou bien un argument délirant qui empêche l'instauration de tout discours, même scientifique, qui nierait la toute-puissance fantasmée de la technique, et limiterait le pouvoir réel de ceux qui la produisent.
Black Mirror, la fameuse série dystopique, excellait à montrer la technique dans ce mouvement de balancier dont on parlait tout à l'heure : rien n'est acquis, sans qu'autre chose ne soit détruit. L'épisode Chute libre (saison 3, épisode 1), où les gens se notent les uns les autres (comme on note des lieux sur internet), en est un exemple.

On pourrait arguer, pour défendre cette idée horrible, qu'elle permet plus de sécurité, de politesse, etc. Mais en même temps, c'est un contrôle permanent de chacun par tous. L'identité s'inféode à des normes sociales, et de nombreux moyens de répressions font de ses normes une contrainte extrêment rigide (une note basse peut priver de certains droits). Et l'on devine les raisons économiques et autoritaires qui imposent le choix de cette technologie-là : l'épisode invente même des coachs en charisme, et montre le commerce juteux qui découle de cette nouvelle nécessité : être charmant.
La dystopie, et ses ressources narratives, est donc particulièrement adaptée à l'expression des critiques qu'on peut faire au progrès ; parce qu'elle révèle les conflits provoqués par le progrès et la technique, sur les gens et sur l'environnement (naturel et social). La dystopie a pour but de rendre politique le progrès, alors qu'il est, dans notre société, produit en grande partie par des organismes privés ; qu'il est un pouvoir volé qui refuse de s'admettre tel.
3.
| Dystopie et liberté
La dystopie, surtout celle de ces dernières années, s'apparente à une découverte du désir - à travers la révolte. L'ordre que les personnages refusent se donne comme un idéal, qui dans le même temps ôte, autant que possible, la possibilité de le critiquer et d'aller contre : par ce procédé, la seule possibilité de révolte passe par l'expression pure et simple du désir, quand bien même il ne possède encore ni forme ni objet (dont la connaissance peut constituer la quête, justement, du héros dystopique).
L'autoritarisme des dystopies se dévoile en ceci, que tout mouvement contre elle est un renoncement. Les personnages, pour s'émanciper, doivent d'abord abandonner leurs repères psychiques, intellectuels, et leurs moyens d'agir, parfois jusqu'à leurs identités. La Zone du Dehors, de Damasio, reprend le système de Nous Autres (Evgueni Zamiatine, 1920) et de L'Âge de Cristal (Michael Anderson, 1976), où les gens sont nommés selon un numéro : le héros de Damasio s'appelle CAPT ; le président s'appelle A, le premier ministre, B, et le dernier des citoyens, ZZZZ (ou quelque chose approchant).
L'alphabet, matière de l'art en ce qui concerne l'écriture, est détourné vers une dépossession du nom ; et plus de nom, plus de lien aux choses, aux autres, plus de sens. Cette suite de lettres est un classement, qui évolue régulièrement, selon la reconnaissance sociale des citoyens, ou leur réussite économique : le moyen de l'aliénation devient également le signe de l'accomplissement individuel.
Le premier acte de rébellion de CAPT sera de refuser de changer son nom. Il s'empare alors de son identité. Il garde CAPT parce que c'est prononçable. Ainsi, le héros détourne le système de classement, en associant un sens au nom - par quoi il réinstaure une profondeur dans le langage, et créé, déjà, les prémisses d'une poétique. Mais dans le même temps, il renonce à toute récompense de la part du système, à toute mobilité sociale, reconnaissance, etc.
Fait plus marquant : toute la quête de CAPT, à partir du moment où il s'est baptisé, est tournée vers la création d'un nouveau système politique. La réussite de cette quête importe moins, ceci dit, que le vivre-ensemble créé par le mouvement même de la révolte : le moyen supplante et surpasse la fin, parce que le moyen est le moment de vraie pratique de la politique, de libération du désir, d'exploration de soi, et d'instauration de l'identité.
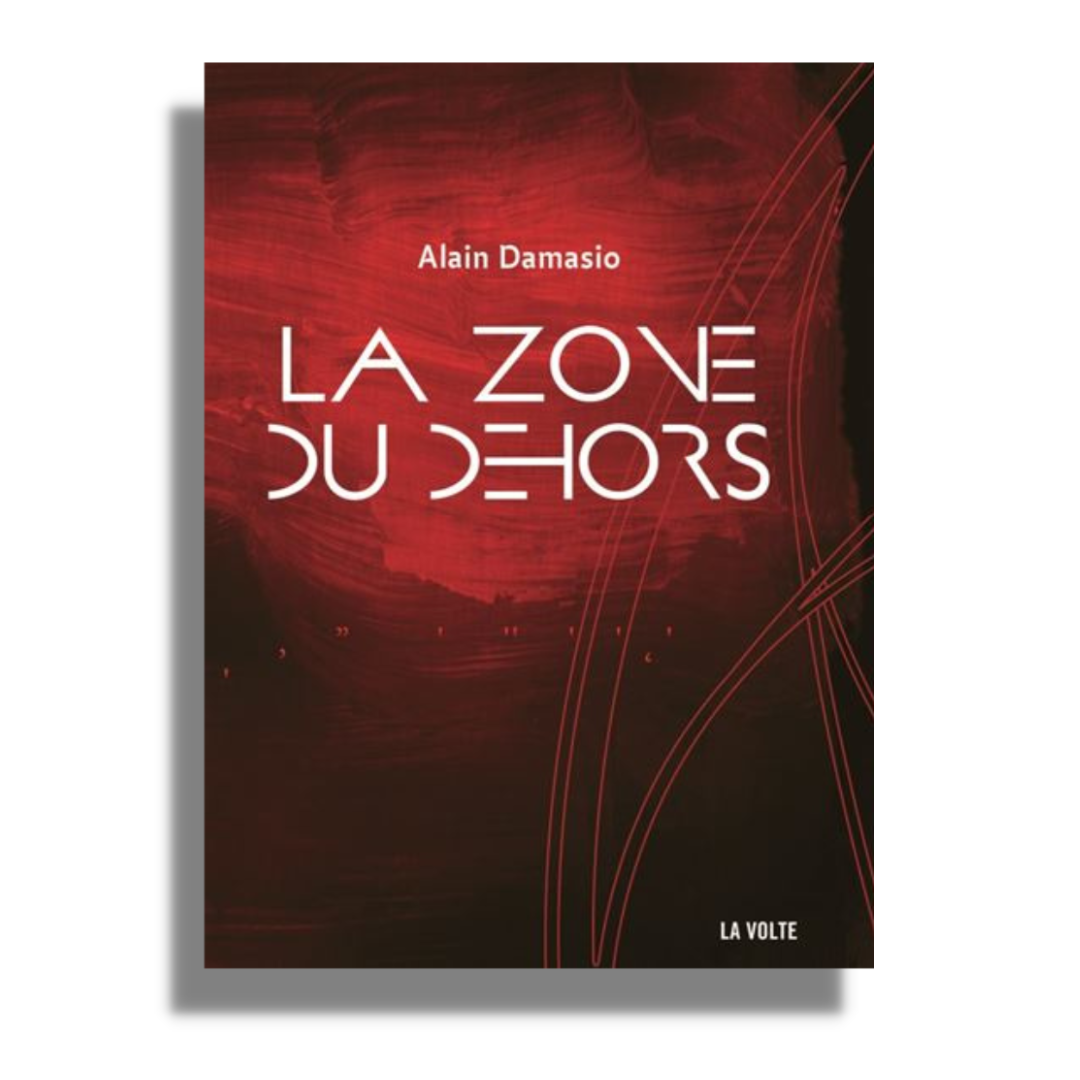
Le récit dystopique met en scène l’affirmation d’une liberté, dans laquelle seule peut se constituer l’identité de ses personnages. L'alternative, la soumission, apparaît alors dans toute son horreur, malgré les avantages dont elle peut se targuer : l'espace de l'ordre devient un espace de non-vie, et parce qu'aucune adhésion n'y découle du désir ; c'est un non-lieu plein de non-sens. Il ne s'y trouve plus que des procédés, et une pensée mécanique de l'être humain comme de la politique.
Si la dystopie met en scène la libération de personnages fictifs, elle accomplit une autre libération, bien réelle, pour le lecteur. Le message, qu'on retrouve comme un écho de livre en livre, est celui-là : il n'y a ni connaissance, ni désir, ni vie, ni rien, qui ne procède de l'identité, de la reconnaissance de soi, des forces qui nous habitent et de notre pouvoir - à comprendre, à désirer, à vivre.
Une idée que l'on accepterait sans la comprendre, deviendrait un mot d'ordre. Et le vivre-ensemble ne peut s'épanouir que lorsque que chacun respecte, à tout prix, sa compréhension intime et sensible du monde qui l'entoure - quand bien même cette compréhension est boiteuse, incomplète.
Certes, la dystopie est désabusée, désespérée parfois, elle fait voler en miettes la séduction des idéaux et les mirages de l’utopie : mais cet éclatement du rêve est riche d’une valeur émancipatrice qui la rend jubilatoire.
La dystopie affirme le caractère à la fois exaltant et décevant de toute fiction, politique ou littéraire. Toutes, elles sont ambivalentes, elles exigent de leurs lecteurs pour être consommées qu’ils sachent changer de point de vue, de perspectives, de désirs, d’exercer leur regard critique.
Mais c'est ainsi que la dystopie fait grandir ses lecteurs : elle les force à affirmer leurs propres manières de raisonner, à s'approprier leur pensée.
« Je dystopise, donc je suis », nous dit Laurent Bazin, en conclusion de son petit livre - et nous le suivons dans ces propos, pour conclure notre suite de dossiers sur la dystopie.
4.
| Conseils de lecture
Ce ne sera sans doute pas notre conseil le plus original, mais voici un livre qui vaut le coup, pour tous les amateurs de dystopie et tous les autres. Les Furtifs, d'Alain Damasio, n'est pas son meilleur livre. Il est le premier à le reconnaître. Mais ce qui y manque de feu, d'émotion dévorante rejaillissant en giclées poétiques, et qu'on avait dans La Horde du Contrevent, on le retrouve dans une profondeur d'écriture inouïe, détaillée, riche d'échos où le lecteur attentif trouvera plus de pensées que dans les trop lourds exposés philosophiques de La Zone du Dehors.
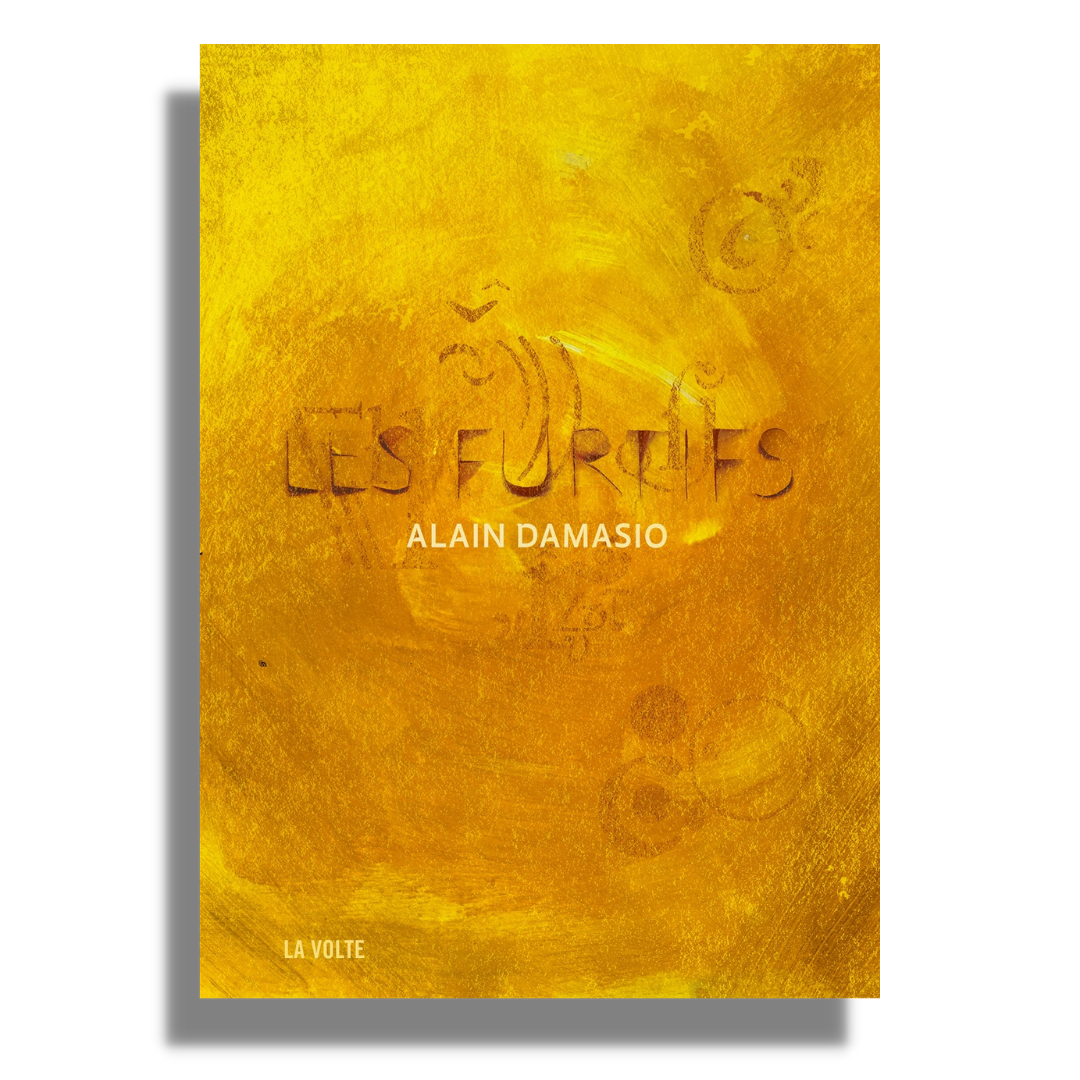
Ici, la dystopie se double d'un élément magique, presque fantasy-urbaine : dans un futur proche, où sont réalisées les pires ambitions néolibérales (privatisation de l'espace public, dont l'accès est soumis à un abonnement ; privatisation de l'enseignement, de la médecine, des villes même qui sont rachetées. Orange, avec humour, est racheté par... Orange°tm), on découvre l'existence de ces êtres bizarre qui sont les furtifs.
Évidemment, on retrouve dans ce récit l'obsession de Damasio pour la surveillance : dans les villes, si la justice n'est pas particulièrement sévère, chaque citoyen est traité comme un suspect, et donc comme un délinquant.
En face, comme moyen de la révolte, il y a la furtivité. Il s'agit à la fois d'une aptitude réelle acquise peu à peu par les personnages, et d'une idée philosophique. Dans cette furtivité, qui devient le mode d'existence de nos personnages, en fuite, clandestins, on ressent l'instabilité du monde. Vivre, devient comme naviguer dans un archipel d'alternatives, dont aucune île n'est plus réelle que les autres.
Voilà ce que pointe Damasio, et qui est jubilatoire : exister, c'est être plusieurs soi à la fois, de manière que le nom ne renvoie ni à notre caractère, ni à notre place dans la société, mais à cette liberté inaliénable - tant qu'on veut bien s'en emparer - de déterminer son propre devenir.
Conseil plus original, en revanche, 2055_ des éditions Glitch. Ce roman collaboratif réalisé dans le cadre du master CREM de la Sorbonne est la démonstration que la dystopie inspire toujours la création littéraire. L’ouvrage, parrainé par Alain Damasio (chez Syfy, on a de la suite dans les idées), répondait au thème « Soleil Vert : 2022 ». C’est un roman collaboratif dystopique, écrit à plusieurs mains, composé d’un fil narratif entrecoupé d’archives fictives obtenues après un appel à contributions.

C’est l’histoire d’Andie, une jeune fille vivant en 2099, dans un monde qui va bien. Ni pollution, ni misère, ni guerre. Tout cela est de l’histoire ancienne. Si ancienne que personne ne semble s’en souvenir. Jusqu’à ce qu’Andie découvre dans le grenier de ses parents disparus une armoire pleine d’archives de cette époque frappée du sceau du secret. Commence alors une enquête mémorielle qui l’amènera à percer les mystères la société ascétisée dans laquelle elle vit.
On tenait à mettre en avant ce projet aussi audacieux dans sa forme (un beau livre illustré au service d’un récit unifiant des archives très variée), son processus créatif (une promo de 30 apprentis éditeurs et des dizaines de contributeurs) que dans le propos qu’il défend. Le jeu rétrospectif permet, au lecteur d’aujourd’hui, de découvrir son futur, un passé révolu dans l’histoire. Entre crises écologiques, politiques et autres joyeusetés, 2055_ s’empare des anxiétés de toute une génération pour leur donner une dimension fictionnelle et les exorciser. Les auteurs sont allés très loin dans l’horreur et si l’héroïne vit dans un monde guéri, on se demande quand-même si le livre est porteur d’espoir.
Il reste, comme dans Les furtifs, un personnage privé de son passé, qui, par l’apprentissage qu’elle en fera, comprendra le prix de l’émancipation et de la liberté.
Ainsi, on pourrait donner un nouveau mot de la fin à cette suite de dossiers sur la dystopie, qui en est comme la morale : se constituer une identité d'être humain libre, c'est faire que son nom désigne une puissance, qu'il appartient à chacun de refaçonner sans cesse.