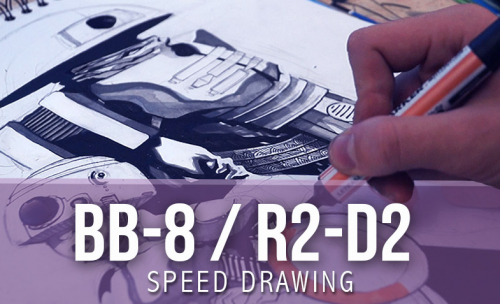« Laissez moi vous dire que je ne connais qu'une personne au monde qui manie aussi bien la caméra que Rian Johnson. Et c'est un certain Steven Spielberg... » : C'est avec cette jolie phrase d'accroche que Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm et productrice derrière la filmographie du grand Steven, introduisait Rian Johnson à un parterre de fans réunis à l'occasion de l'ultime panel de la Star Wars Celebration, où le réalisateur partait, pour la première fois publiquement, à la rencontre des aficionados de la saga. Un tonnerre d'applaudissements plus tard, c'est un réalisateur plein de bonhommie et armé d'un certain humour à froid qui se présentait auWaries, dévoilant quelques maigres de détails sur le tant attendu huitième chapitre de la saga Star Wars. Et puisque les informations sur le prochain film de Rian Johnson sont vouées à se faire discrètes pour quelques mois encore, replongeons-nous plutôt dans l'étonnante filmographie du metteur en scène, qui a peut-être bien tous les atouts réunis dans sa manche pour nous offrir un Star Wars mémorable.
Le temps, c'est de l'argent
Il n'est pas toujours pertinent de remonter dans le passé et la formation d'un réalisateur pour comprendre son art. Mais dans le cas de Rian Johnson, le voyage dans le temps est tout à fait approprié. Un plus d'un titre d'ailleurs. Le jeune Rian a grandi en Californie, eldorado du cinéma américain, qui forma le futur réalisateur sur les bancs de l'USC of cinematic arts, à San Clemente. Si elle n'est pas forcément la plus (re)connue de l'état, l'école ne laissera jamais Rian Johnson la quitter, puisque des années après son diplôme, il y reviendra pour tourner son premier film, Brick, sorti en 2005, pour des raisons financières, essentiellement, mais des raisons qui arrangent bien notre première analyse de sa filmographie : un rapport tout particulier au temps qui passe.

Pour son premier film, Rian Johnson retourne donc sur les bancs de l'école qui l'a forgé. Une première boucle se voit d'ailleurs bouclée puisqu'il est question, dans Brick, d'un étudiant à la recherche de son ex-petite amie disparue, qui fréquentera les lieux, les professeurs et autres spécialistes de la vie scolaire qui accompagnèrent Johnson durant ses études. Bien entendus, se sont des acteurs qui endosseront ces rôles ou plutôt ces brèves apparitions, mais les noms se veulent tout à fait authentiques. Ici, Johnson remonte donc le temps, une première fois, pour explorer les couloirs de sa propre faculté, mais sous un autre angle, celui d'une enquête qui vire au film noir, avant d'inventer sa propre mythologie, très comic book dans l'âme. On ne saurait trop s'avancer sur la jeunesse du réalisateur, mais les égards amoureux du personnage principal, incarné par l'excellent (et alors débutant) Joseph Gordon-Levitt, greffés à l'ambiance et la narration très singulières de Brick nous renvoient directement à nos fantasmes d'(ex-)étudiants passionnés par les cultures de l'imaginaire.
Évidemment, impossible d'évoquer le temps qui passe sans s'attarder sur le troisième métrage de Rian Johnson, Looper, sans doute le plus connu de sa filmographie, du moins, en attendant la sortie d'un huitième Star Wars encore sans titre. Proche d'un Source Code (de Duncan Jones) et des recettes modernes du voyage dans le temps, Looper, qui tire son nom du mot anglais Loop (boucle), est aussi fascinant que l'Ouroboros, le serpent qui se mort la queue. On y retrouve Gordon-Levitt dans le rôle principal, celui d'un Looper, donc, néologisme qui désigne les tueurs à gages chargés d’exécuter et de faire disparaître des cibles qui leur sont envoyées du futur. Un pitch des plus accrocheurs, qui donnera certes naissance à quelques imperfections (les plus pointilleux d'entre-vous décortiqueront facilement les failles du voyage dans le temps tel que mis en scène par Johnson) mais surtout à de brillantes originalités, qui mine de rien, ont dépoussiéré le genre. On pense notamment aux liens qu'entretiennent ici un corps et sa version future, qui sont généralement bottés en touche par les auteurs, se référant à une convention selon laquelle on ne doit surtout pas rencontrer son futur soi.
« I'm saying that I lived too long »

Dans l'épisode, Johnson utilise en effet toute la puissance de son cadrage et de son style classique mais très élégant pour exacerber la descente aux enfers de Walter, qui menace pour la première fois Skyler, sa femme. C'est le point de trop, celui qui fait passer le personnage de l'autre côté de la moyenne. Le mal ronge maintenant 51% de son être, et quelque chose nous dit que la maîtrise de Johnson sur le sujet annonce de très belles scènes pour notre ami Kylo Ren. Mais revenons à nos moutons, puisque l'épisode est, comme la filmographie du bonhomme d'ailleurs, chargé d'inserts sur des réveils, des horloges et surtout, gravite autour d'une montre offerte par Jesse à Walter, en signe de leur entente renouvelée. Comme vous le savez, celle-ci ne durera guère longtemps puisque Johnson terminera sur Ozymandias, du nom du poème de Percy Bysse Shelley (relatant la chute d'un empire), qui s'ouvre, sans surprise pour quiconque aura suivi notre propos, sur un flashback. Retour à la saison 1 le temps d'une introduction, comme si Johnson, tel un Looper, s'assurait encore une fois du bouclage de la boucle. Par ailleurs, l'épisode, l'un des rares au monde à être noté 10/10 sur IMDb (pour ce que cela vaut), se permet de terminer un dialogue entre Jesse et Walter entamé dans The Fly, et qui concerne la défunte petite ami de Jesse, incarnée par Krysten Ritter.
Respect des anciens
Rien n'est donc laissé au hasard dans la filmographie de Johnson, et cela se ressent d'ailleurs dans la composition de ses plans, qui ont souvent - et en ce sens, on ne peut qu'être d'accord avec Kathleen Kennedy - ce caractère inimitable, ce classicisme si soigné qu'il transforme chaque image en icône. Or, on s'habitue si vite à la qualité qu'on en oublie la puissance géométrique des cadrages de Johnson, émouvants quelques soient le sujet ou le budget. De Brick à Looper en passant par Breaking Bad ou The Brothers Bloom (Une Arnaque Presque Parfaite, en français) , on retrouve ainsi un même sens de l'image qui ne saura que sublimer un univers aussi visuel que celui de Star Wars, où chaque plan se doit d'être marquant et chaque décor, chaque personnage, chaque véhicule a une histoire. Et y-a-t-il meilleure manière, pour les faire vivre, que la précision de Rian Johnson ?
Assurément, dans les cadres de Johnson et son utilisation régulière des rails et des grues -pour des plans plus fluides - transparaît un certain respect pour l'ancienne école. Ce qui ne veut pas dire que le bonhomme est prisonnier des codes instaurés par ses aînés. Simplement, au contraire d'un Abrams qui s'y frottait directement, pour mieux les bousculer avec tous les outils modernes à sa disposition (comme les fonds verts et les caméras virtuelles) Johnson a appris à les domestiquer. Et la modernité visuelle du réalisateur passe ainsi par des plans très originaux mais rarement tape-à-l'œil, une forme de discrétion (assez typique de la démarche du bonhomme sur la scène de la Star Wars Celebration) qui ne doit pas nous faire oublier le travail de fond de Johnson. Dans tous ses films, mais également dans ses épisodes de Breaking Bad, le réalisateur fait par exemple preuve d'un soin tout particulier à l'égard des raccords. Point de jump cuts ou d'effets de style, la plupart des transitions d'une image à l'autre se veulent naturelles, même lorsqu'elle ne peuvent, physiquement, pas l'être.

Johnson emprunte ainsi à la bande-dessinée des raccords typiques du neuvième art, utilisant parfois la mutation du sujet à l'écran en un autre sujet par souci de fluidité, un processus que les lecteurs de BD et surtout de comic books connaissent très bien. D'un plan à l'autre, le « A » d'une lettre griffonnée sur le papier peut ainsi devenir l'arche d'un pont, par exemple. Mais le lien entre Johnson et le milieu de la bande-dessinée américaine ne s'arrête pas là, puisque le réalisateur, également scénariste, partage avec tous les auteurs de comic books une fascination certaine pour la constructions de mythologies et d'univers à part entière. Comme on le disait, dans Star Wars, tout a une histoire. Mais c'est aussi le cas dans Looper, qui a ses tueurs à gages, ses motos défiant la gravité, ses pouvoirs psychiques et tout un tas d'autres éléments de contextualisation qui ont été pensés pour nous immerger dans cet univers. On retrouve la même démarche dans The Brothers Bloom et toutes leurs combines, puisque le sujet même du film est d'inventer des histoires pour tout et n'importe quoi, et ce dans les moindres détails, pour rendre chaque arnaque crédible. Même Brick, qui est effectivement le moins fantasmagorique des films du réalisateur, impose progressivement une mythologie au spectateur, en mettant en scène des soirées étudiantes qui ont l'air d'être bien plus que de simples beuveries ou des criminels au look surréaliste, fringués à la manière du Sin City de Frank Miller, pour ne citer qu'un exemple.
Comme l'auteur de 300, Johnson semble également comprendre les codes de l'une des plus puissantes mythologies américaines qu'il soit, celle du western. Or, pour tout un pan de fans, Star Wars en est un, et en restera toujours un. Et si la saga reprend des thèmes et tourne dans des décors très européens, Star Wars sera effectivement toujours, et parfois trop, une histoire américaine. Une histoire où des chasseurs de primes crasseux se croisent dans une cantina à peine plus propre, pour monter leur nouveau coup. Or, avec l'enquête de Brick, les gags et les slap sticks (mots savants pour désigner la chute, souvent très visuelle, d'une blague) de The Brothers Bloom et les duels de Looper, Rian Johnson a déjà prouvé qu'il connaissait et comprenait ce genre, et saurait donc se l'approprier en marchant sur le sol des planètes d'une galaxie lointaine, très lointaine. Par ailleurs, en revenant à l'une des sources de Star Wars, nul doute que le réalisateur saura boucler une nouvelle boucle dans un huitième opus dont la filmographie de Johnson est, à l'heure où j'écris ces lignes, la meilleure promotion.

Reste à savoir si le principal intéressé pourra ou saura injecter tout son art au sein de la franchise la plus puissante de l'histoire du septième art. Et si on peut encore avoir des doutes sur la question, plusieurs indices vont déjà dans le sens d'un huitième opus très Johnsonien. Tout d'abord, le nom du réalisateur gravite autour de Star Wars depuis des années maintenant, puisqu'on apprenait son arrivée à la barre du huitième opus en juin 2014. A croire que Kathleen Kennedy l'a toujours imaginé comme le piment d'une postlogie qui finalement, se devait de relancer Star Wars sur des bases familières, pour mieux les secouer ensuite. Mais plus explicite encore, la première règle que Rian Johnson a fait voler en éclat en rejoignant la galaxie Star Wars : aucune ellipse ne séparera son film de The Force Awakens. Ce qui, au sein de la saga, est une originalité majeure, mais ô combien adaptée à la filmographie du bonhomme et ses thèmes favoris. Comme si, pour Star Wars, Johnson ne jouait plus les parfaits Loopers, mais plutôt le rôle de l'explorateur temporel qu'était le personnage de Bruce Willis dans son film. Un fauteur de troubles qui saura renverser la saga le temps d'un opus, histoire d'offrir à la création de George Lucas un twist digne de celui de l'Empire Contre-Attaque. Autant vous dire que la pression sur les épaules de Johnson est immense. Mais on vous le dit encore une dernière fois, croyez-nous, ces épaules-là sont solides.