
Il y a deux semaines, nous avons affirmé que la naissance de la dystopie est contenue dans celle de l’Utopie, qu’elle est sous-entendue dans le texte de Thomas More et dans ses illustrations. Voici la définition, ou plutôt les caractéristiques, que nous pouvions alors donner de la dystopie : elle nous emmène comme un étranger dans un monde qui peut aussi bien être neuf que semblable au notre, dont les éléments ont des significations ambigües, afin surtout de remettre en question notre manière de penser.
Pour retrouver le premier épisode, au grand complet, c'est ici !
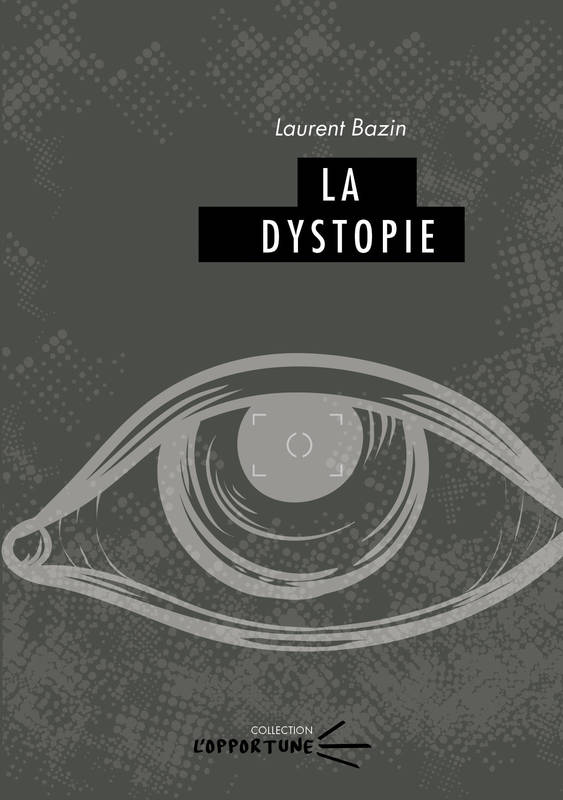
Aujourd’hui, on explorera un peu l’histoire de la dystopie ! Avec, comme guide, ainsi que la dernière fois, le critique Laurent Bazin et son petit livre La Dystopie.
Une telle histoire n’est pas sans conséquences : plutôt qu’une opposition entre une époque contemporaine désabusée, qui aurait perdu la foi pour certains dans la politique, pour d’autres en la capacité de l’être humain à être bon, et un passé naïf - dont la pensée est invalidée ou presque par sa candeur, une histoire de la dystopie démarrant avec la renaissance montre que l’espoir d'un avenir meilleur ne s’est jamais maintenu sans être assailli par le doute, que le progrès a toujours contenu simultanément de la lumière et de l’ombre. Une telle histoire permet de mieux saisir contre quelles craintes a été fondée notre pensée politique et nos représentations de l’être humain.

Il n’est pas indifférent que l’utopie soit apparue avec les grandes explorations de l’occident. Le « monde sans lieu », sens étymologique de l'« utopie », est imaginé en un temps où l’on savait que la terre regorgeait de mondes inconnus. L’impossibilité de l’utopie est alors envisagée d’un point de vue politique ou moral, il s'agit plutôt d'une incompatibilité avec l'Europe de l'époque - tant les possibilités paraissaient infinies, au vu de l'étrangeté, pour nos vieux philosophes, des peuples rencontrés. Au même moment, la société abandonne la religion comme unique boussole, et lui substitue ce qu’ont de désirables les projets qu’on lui tend. La connaissance du globe fournit à la raison les outils nécessaires à l’avènement sur terre du paradis (ou du moins à son avènement comme projet raisonnable).
Le monde réel devient finalement une référence négative, tandis que l’utopie est peu à peu la dépositaire des idéaux progressistes.
Dans une optique qu’on pourrait aujourd’hui appeler militante, les auteurs avaient adopté une forme de récit nommé le mundus inversus : d’abord une satire d’un modèle qu’on cherche à dénoncer, puis un idéal mis en contrepoint. Le Gargantua de Rabelais (1534) oppose ainsi la sereine abbaye de Thélème aux méchants pichrocolins (nom tiré du grec pour dire mauvaise humeur). Le monde réel devient finalement une référence négative, tandis que l’utopie est peu à peu la dépositaire des idéaux progressistes. Mais en encourageant la conscience critique vis-à-vis de la société, elle est contrainte de s’appliquer ses propres outils critiques, de remettre en question la validité de ses propres modèles. Ainsi, dans La nouvelle Atlantide de Francis Bacon (1623), le pouvoir est aux mains des sages et des savants : les dirigeants multiplient les techniques d’intimidations, pour convaincre chacun de sa stupidité, et confisque les divers accès à la connaissance.

En réaction, et pour éviter cet écueil, d’autres écrivains font de leurs personnages des voyageurs qui rencontreront de nombreuses sociétés diverses qu’ils jaugent, y voyant tout à tour des repoussoirs et des refuges.
Si l’utopie décrit des fonctions sociales fixées, elle est en effet totalitaire, car elle s’oppose à la pratique de la politique comme redéfinition des identités, des pratiques sociales et des hiérarchies.
Dans États et empires de la lune et du soleil de Cyrano de Bergerac (1657-1662), le héros Dyrcona n'a jamais qu’un rôle d'observateur dans les sociétés qu’il rencontre, elles deviennent le prétexte d’aventures et de paraboles. Ces voyages-là finissent par le retour chez soi : chargé d’enseignements peut-être, mais sans plus d’espoir d’un ailleurs utopique. Au XVIIIe siècle, pendant les lumières, le fourmillement des idées nouvelles met plus que jamais l’utopie à la mode : Candide, de Voltaire, en montre une via l’Eldorado ; Candide la quitte, parce que les exigences de liberté de l’époque s’accommodent mal des idéaux collectifs, des systèmes rigides. Un bonheur imposé n’est plus désirable ; il est ennui ou cauchemar.
Plutôt que d’y voir une caractéristique de la pensée libérale ou de l’individualisme de l’époque, il est possible d’y reconnaître une nouvelle progression de la pensée dystopique : si l’utopie décrit des fonctions sociales fixées, elle est en effet totalitaire, car elle s’oppose à la pratique de la politique comme redéfinition des identités, des pratiques sociales et des hiérarchies. La pratique de la dystopie, en ce qu’elle remet sans cesse en cause la fixité de l’utopie, est donc une pratique littéraire politique au sens le plus essentiel du terme.

Ce que développe le XVIIIe siècle, c’est que l’Utopie ne se maintient qu'aussi longtemps qu'elle apparaît désirable ; changer de perspective, quitter le désir, c’est créer la dystopie, et c’est là qu'elle entame ses réflexions - et à sa manière le maintient du désir de création politique - de vie. La création d’un idéal commun n’est certes pas contraire au bonheur individuel, du moins tant que cet idéal est une pulsion, même violente, rationalisée et reconduite par le maintien de sa nature pulsionnelle. La politique comme système, nous disent la dystopie et les philosophes des lumières, voilà l’ennemi. Qu’est-ce qui oppose, alors, l'individu à l'État - la fourmi au Léviathan ? C’est moins, selon cette histoire, leurs forces respectives que l’espace où ils règnent ; l'État, sur la pensée comme structure logique qui s’use, l'individu, sur l’espace plus concret du désir et de l’invention ; ce qui n’empêche pas le commun.











